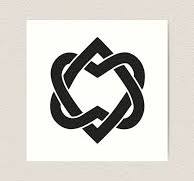
Une fois n’est pas coutume, ce billet de blog en rebond sur un propos de Leonard Cohen vient s’enchaîner au précédent, consacré à l’exposition d’Olga de Amaral.
Je découvre en effet dans une conférence de l’artiste textile prononcée au Metropolitan Museum of Art d’avril 2003 (reproduite dans le copieux catalogue de la Fondation Cartier et intitulée « La Maison de mon imagination » pages 130-131), la mention d’une technique ancestrale mise en œuvre au XVe siècle au Japon, le kintsugi ; elle consiste à réparer un objet cassé en mettant en valeur ses lignes de fracture, ou de faille, avec de la poudre d’or, d’argent ou de platine. Au lieu de masquer l’intervention, ce procédé surligne l’épreuve traversée par l’objet ainsi rafistolé. Cette opération apparemment contradictoire, qui tire son nom de kin (or) et tsugi (jointure), « jointure à l’or » donc, exhibe à la fois la fracture, et sa guérison. Celle-ci n’efface pas, elle recueille le travail supplémentaire provoqué par l’accident, mémorisé et réparé par l’intervention habile de l’artisan.
Comment ne pas songer à la chanson de Cohen « Anthem », et à ce distique qui court à travers toute son œuvre, comme une maxime, « There is a crack, a crack in everything / That’s how the light gets in » – Il y a une fêlure, une fêlure en toute chose / C’est par elle que la lumière rentre ?
La plupart des chansons de Cohen n’ont-elles pas pour fil conducteur ce fil d’or de la fêlure, la veine aurifère de nos cicatrices ?
J’y songeais particulièrement en reprenant les ouvrages de François Jullien récemment consacrés à la « décoïncidence », dont le philosophe a fait pour sa part son mot d’ordre, et le titre d’une association. Dé-coïncider, c’est éprouver un écart qui nous divise, qui révèle une blessure intime où notre identité, notre sentiment de complétude avec nous-mêmes se trouvent déséquilibrés ou remis en cause. Or ce sentiment ou cet état sont inséparables du mouvement même de la vie : vivre, grandir, désirer, vouloir…, en un mot « ex-sister » (étymologiquement se tenir hors de), c’est décoïncider d’une adhésion première, d’une assiette ou d’une assise désormais fracturées, ou remises à plus tard.
La vraie vie autrement dit ne consiste pas à s’enclore, à coller à ses propriétés, à une supposée identité, ou à un clan, une communauté, une définition socio-professionnelle ou mondaine de son personnage…, mais à s’ouvrir, au risque d’une déstabilisation, voire d’une blessure infligée à une première et sécurisante clôture. À un statut qui tourne chez certains à la statue, marmoréenne, privée de vie.
Car telle est, de fait, la pente naturelle de toute vie. Nous sommes guettés par l’enlisement, la répétition, la routine qui nous simplifient, nous bornent et insidieusement nous machinisent. Nos plus beaux élans, ceux de l’amour par exemple, retombent en journées de couple ou de ménage bien différentes des folles saisons de la rencontre : au fil de nos vies, certains paliers se proposent qui nous suggèrent que c’est assez, qu’une réussite, une cohérence, un accomplissement sont atteints sur lesquels désormais nous pouvons nous reposer, au moins est-ce ainsi que raisonnent les hommes faits.
Il n’en va pas différemment dans le domaine de la pensée ; penser vraiment, c’est fracturer, fissurer, sortir d’un cercle ou d’un carré où nous demeurions prisonniers (sans le savoir) de nos premières évidences, auxquelles nous collons ou tenons d’autant plus qu’elles furent parfois chèrement acquises, avant de se changer traitreusement en système. Dans ce domaine aussi, des paliers stabilisateurs nous suggèrent que c’est assez, ou que c’est ainsi, qu’il n’y a rien à chercher au-delà.
(Je songeais à cette déchéance de nos plus beaux élans en visitant l’exposition de Beaubourg consacrée au surréalisme, et plus précisément au centenaire du Manifeste du surréalisme par Breton ; visite prolongée pour moi par notre débat du samedi 11 janvier à la Halle Saint-Pierre ; comment raviver cette flamme, souffler sur ces braises ? Car les textes d’Aragon et de Breton pourraient encore nous brûler, nous illuminer, mais ils sont pour la plupart dorénavant classés, ou par cette exposition même embaumés, comment leur rendre leur tranchant, leur force (qui fut irrésistible) de mobilisation ? Me revenait en mémoire la phrase cruelle de Sartre autour de 1947, parlant du « bonbon si vite sucé de l’exposition surréaliste » d’alors. Et certes, Sartre avait ses raisons de tenir Breton à bonne distance, l’existentialisme de cette seconde après-guerre jouant le rôle qui avait été celui du surréalisme des années vingt. L’histoire ne se répète pas, les œuvres se classent et nos commémorations ont un goût de cendre. Comme cette revue que je feuillette, Alcheringa, fort bien composée et mise en pages, et qui voudrait sous l’impulsion du fougueux Joël Gayraud nous refaire à cent ans de distance le coup de l’écriture automatique, du cadavre exquis, du récit de rêve ou d’une imagerie démarquée de ces années de feu – à qui porter celui-ci, comment le faire reprendre ? Un mot en -isme, surréalisme comme christianisme, ou marxisme, est peut-être la plus sûre façon d’enterrer un mouvement : il est le nom que prennent des idées d’abord jaillissantes, quand les média ou l’opinion s’en emparent.)
Mais revenons à Leonard Cohen, qui sut si bien d’un disque à l’autre déjouer l’enlisement, et nous surprendre. Qui sut à ce point incarner tant d’hommes différents, sans se laisser rattraper ou dévorer par son personnage. Comme il répondait à la fin de sa vie à une passante ravie qui le reconnaissait dans la rue, « Are you Leonard Cohen ? – I used to be »… Comment ne pas se laisser enclore, enfermer, résumer, fût-ce par son propre nom ?
L’identité n’est pas sûre, et le chant transforme la voix. Mais Cohen raviva au fil de ses chansons plusieurs blessures intimes, et il chercha délibérément auprès de ses successives (et si nombreuses) compagnes un vacillement de lui-même, un vertige salutaire. La gravité qui fut la sienne à l’approche du féminin, si nous en croyons tant de chansons, rejoint son choix de la méditation, du jeûne et de la prière. Nous ne savons pas à quoi pensait Cohen (Jikan-le-silencieux !) lors des longues séances nocturnes de méditation dans sa cellule du mont Baldy. Moments de recueillement et de réparation de ses blessures, de recollement d’un soi – ou au contraire recherche du vide et dislocation d’une pensée partie en vrille, en fumée ? L’insistance de cette dernière figure dans plusieurs chansons plaide il me semble pour une éthique de la décoïncidence, une quête de la dépersonnalisation, en amour comme dans ce que nous appellerons après plusieurs commentateurs la quête mystique de Leonard Cohen.
L’amour nous arrache à nous-mêmes, il opère dans le vif une brèche par où la lumière rentre. Mais comme on le chante aussi depuis Aragon, « il n’y a pas d’amour heureux », le comblement amoureux est indissociable d’un tumulte, d’une blessure qui nous portent à un degré supérieur d’ex-sistence. Ce qui incita Cohen à figurer, sous forme d’étoile de David, la superposition des cœurs brisés partout reproduite dans ses livres ou ses pochettes de disques. Aimer c’est surmonter une clôture, se risquer vers un Autre ou en vue d’une vie double qui nous intranquillisent, nous déstabilisent. Mais cette quête d’infini prépare aussi aux élans mystiques ou religieux, par lesquels nous tentons de nous unir à la figure qui englobe toutes les autres, Dieu, G.d (écrit Cohen) ou l’univers… Dieu comme les femmes démesurent le chanteur, le déportent hors de lui. Ce qu’on peut dire aussi de toute véritable rencontre.
Il est frappant que la voix, qui décrit si bien dans tant de chansons les méandres du cœur brisé, soit aussi le remède qui raccommode et répare : guérison, « healing » est ainsi le maître-mot d’une merveilleuse chanson du disque Old Ideas (2012) dont la photo de couverture, sur la pochette, montre une ombre grandissante pointée vers le chanteur dans son petit jardin de Los Angeles. « Come healing of the body / Come healing of the mind – Vienne la guérison du corps / Vienne la guérison de l’esprit », répète en refrain le penitential hymn où figure aussi une citation explicite du dessin fétiche de Cohen, l’étoile de David des coeurs unifiés, « The Heart beneath is teaching / To the broken Heart above – Le Cœur du dessus enseigne / Au Cœur brisé en dessous ».
Healing, c’est par la voix qu’on guérit, nous murmure Leonard Cohen reprenant à son compte les antiques thaumaturgies des shamans, des prêtres, des prophètes-poètes. Une voix qu’il a comparée lui-même à un filon aurifère, dans une précédente et illustre chanson, « Tower of songs », « (…) I had no choice / I was born with the gift of a golden voice – Je n’avais pas le choix / Je suis né avec le don de l’or dans ma voix ».
Avec le don d’appliquer la « jointure d’or » (kintsugi) sur nos blessures, nos fractures.

Laisser un commentaire